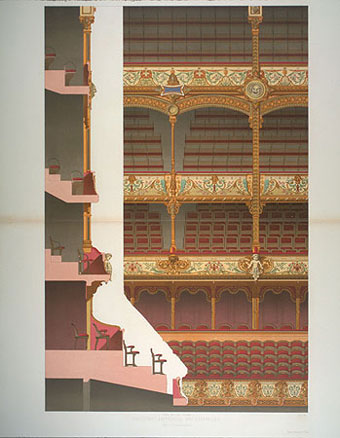Pour nous consoler des malheurs de ce mois, allons donc à l'Opéra...
Evacuons d'abord la plus mauvaise des trois soirées dont je vais parler: je veux évidemment parler de
L'Affaire Makropoulos, dont j'aurai donc vu la première et la dernière. J'y suis retourné non par masochisme, mais par acquis de conscience. Je maintiens donc ce que j'avais écrit sur la médiocrité absolue de la direction de Tomas Hanus, qui ne laisse subsister aucun détail de l'orchestration exceptionnelle de Janacek.
Angela Denoke, qui incarne le "rôle titre", m'est apparue comme l'incarnation des défauts de cette production: une volonté affirmée de jouer sur le charisme hollywoodien qui bute sur l'absence de l'ironie et de l'étrangeté de cette musique. Rien de plus familier, en effet, que ces images de paparazzi ; et le manque d'humour, lié à la certitude de dire des choses sérieuses et importantes, est ce qui me semble caractériser le mieux le metteur en scène Warlikowski (et sans doute aussi toute la politique de Gerard Mortier...).
Heureusement, le lendemain:
Lohengrin de Wagner, dans une production déjà assez âgée de Robert Carsen. Il faut bien dire que ce n'est pas le travail de Carsen, un des plus grands metteurs en scène lyriques d'aujourd'hui, qui fait le prix de cette soirée, pas plus que le travail inégal du chef Valery Gergiev (je ne suis pas un ennemi de Gergiev, mais j'avoue qu'un peu plus de cohérence et de poésie ne m'aurait pas déplu, à l'image de ce qu'aurait pu faire un bon professionnel beaucoup moins flamboyant comme Peter Schneider), sans parler d'un choeur dans ses plus mauvais jours. Non, l'intérêt est dans la distribution, comme on s'en doutait d'ailleurs bien: passons sur le Roi de Jan Hendrik Rootering, pour lequel j'ai une grande sympathie mais dont la voix est si engorgée qu'on ne l'entend presque plus. Ne nous attardons pas sur le Telramund de Jean-Philippe Lafont, alternant merveilles expressives et moments où la voix ne suit plus (le temps a passé depuis un Wozzeck merveilleux,
vraiment chanté, dans cette même salle).

Mais arrêtons-nous sur le trio royal: Ben Heppner, un peu placide peut-être mais parfaitement audible, subtil et constamment à l'aise; une Elsa troublante, pas du tout pure jeune fille mais d'autant plus émouvante, en la personne de la très contestée, très contestable et toujours passionnante Mireille Delunsch. Inclinons-nous, enfin, devant l'art unique de Waltraud Meier, dont chaque apparition est une leçon de chant et de jeu. Regardez son visage tout au long de l'acte I, où elle ne chante presque pas, regardez ses bras, cela vaut cent mille
Actors studio. Ecoutez un timbre unique, un art de la caractérisation qui lui épargne toute surcharge expressive, écoutez sa manière d'utiliser chaque consonne à des fins expressives. C'est souvent cela, un chanteur admirable: un art presque invisible, qui frappe par son évidence et sa simplicité.
On pouvait s'attendre à ce que
Lohengrin soit plein, comme on pouvait s'attendre à ce que
Makropoulos le soit beaucoup moins, à juste titre à chaque fois. Mais pouvait-on penser que la reprise de
Simone Boccanegra de Verdi soit vide à ce point? La mauvaise réputation très excessive, de la mise en scène de Johan Simons a sans doute beaucoup joué, comme l'absence de stars. Pourtant, la représentation du 6 mai (!) a été l'une des meilleures, sinon la meilleure de toutes les représentations verdiennes que j'ai pu voir à Paris et ailleurs.
J'ai plus encore que l'an passé beaucoup apprécié la transposition intelligente de Simons, qui prive le public d'oripeaux d'époque mais pas d'émotion et articule remarquablement enjeux politiques et enjeux personnels des protagonistes. Musicalement, la fête était complète:
Boccanegra, d'abord, est un des plus beaux Verdi, loin devant les déplorables
Trouvère,
Aida ou
Forza qui pourraient sans pertes quitter nos scènes. James Conlon, dans la fosse, est remarquable, comme l'orchestre, et ses chanteurs sont de premier plan, à commencer par Stefano Secco, un ténor verdien comme on n'osait pas en rêver (on courra l'entendre l'an prochain dans
Don Carlo); mais Olga Gouriakova, avec une voix désormais bien alourdie, donne à son personnage une présence et un intérêt qui, avouons-le, ne sont guère dans la partition et encore moins dans le texte.
Dommage pour ceux qui n'étaient pas là...



 Pour nous consoler des malheurs de ce mois, allons donc à l'Opéra...
Pour nous consoler des malheurs de ce mois, allons donc à l'Opéra...